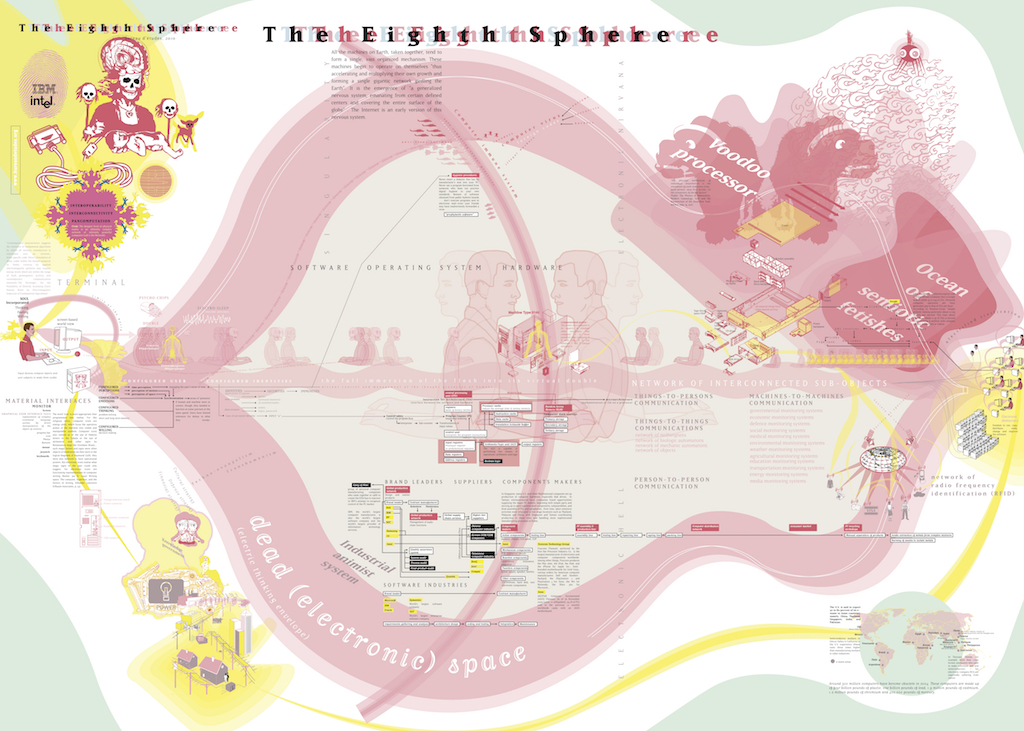Sous l’œil de Mai 68

(Im)possibilités critiques et politiques de l’art contemporain
Depuis un demi-siècle, les événements de mai-juin 68 font en France, à chaque décennie, l’objet de nombreuses publications et expositions. L’une des originalités historiographiques des manifestations de cette année tient à la revisite approfondie de l’implication des artistes plasticiens dans le mouvement et de leurs trajectoires durant « les années 68[1] ».
Les principaux épisodes de cette histoire sont connus. Le 8 mai, à l’instigation des élèves architectes, un comité de grève est créé à l’école des beaux-arts de Paris. Les étudiants sont rejoints par des membres des différents groupements politiques déjà actifs dans le mouvement social et par quelques artistes du Salon de la Jeune Peinture comme Gilles Aillaud, Eduardo Arroyo, Francis Biras, Pierre Buraglio, Henri Cueco, Lucien Fleury, Gérard Fromanger, Merri Jolivet, Julio Le Parc (et le GRAV), Bernard Rancillac, Gérard Tisserand, Christian Zeimert. Une semaine plus tard, une première affiche est imprimée en lithographie à trente exemplaires. Il était prévu de les vendre dans une galerie en sympathie avec les luttes en cours mais, après quelques mètres dans la rue, elles sont arrachées à ceux qui les transportent et collées sur les murs par les étudiants. Elles ne seront pas mises en vente pendant les deux mois qui suivent. Le même jour, un atelier de sérigraphie est installé par Guy de Rougemont et Éric Seydoux afin d’augmenter les tirages. L’Atelier populaire des Beaux-Arts est né. Plus de cinq cents affiches sont produites en quelques semaines et leur diffusion totale s’élève à environ un million d’exemplaires.
Chaque soir, les projets d’affiches sont soumis au vote d’une assemblée générale. Aux Arts Décoratifs, un atelier semblable se constitue à partir du 29 mai, avec des membres plus proches des communistes qu’aux Beaux-Arts, où dominent les maoïstes. D’autres initiatives comparables se développent à la faculté de médecine ou des sciences ainsi qu’en province. À partir du 20 mai, des artistes reconnus comme Pierre Alechinsky, Leonardo Cremonini, Jean Hélion, Asger Jorn, Roberto Matta, Gina Pellon, Paul Rebeyrolle ou Antonio Ségui, préparent eux aussi des affiches aux Beaux-Arts aux côtés de l’Atelier populaire. Mais le 27 juin à 4 heures du matin, le lieu est envahi par les gardes mobiles et fermé dans la foulée[2].
L’aventure que ces ateliers ont incarnée paraît aujourd’hui lointaine et improbable. Elle offre pour cette raison une bonne mesure des changements ayant affecté les relations des artistes visuels avec la politique, en particulier avec ses tendances anticapitalistes et révolutionnaires dont l’expression apparaissait centrale – bien que minoritaire – il y a cinquante ans.
Des ateliers populaires à l’art critique intégré
Au-delà du contenu des affiches produites souvent ouvertement critique envers le capitalisme, une défiance vis-à-vis du marché et des institutions de l’art s’exprimait aussi. Elle se signalait par l’absence presque systématique de signature et le rejet du droit d’auteur, par la diffusion des œuvres en dehors des galeries, des musées et des autres circuits de l’art, par un effort de jonction avec d’autres groupes sociaux comme les étudiants puis, pour certains, les ouvriers dans les années qui suivront, ou encore par la soumission des artistes à des assemblées démocratiques et, enfin, par la combinaison de ces éléments avec l’emploi de technologies alors relativement neuves en France comme la sérigraphie. Pris individuellement, chacun de ces traits pourrait se retrouver dans l’art le plus critique ou le plus utopique des décennies qui suivent. Les collectifs d’artistes ne manquent pas aujourd’hui, certains mettant en cause l’auctorialité individuelle ou la propriété intellectuelle[3]. Des circuits alternatifs de diffusion de l’art se sont multipliés dans les marges du marché et des institutions publiques. L’enquête documentaire ou militante dans les mondes sociaux les plus étrangers à l’art est une matière première centrale des œuvres contemporaines. Quant aux nouvelles technologies, il est inutile de signaler qu’elles informent régulièrement les nouvelles pratiques de création.

Art Keller, Les forces du marché. Série le crâne d’argent, 1994. Acrylique sur toile, 65 × 100 cm.
Collection Yoon-Ja & Paul Devautour MAMCO – inv. 1994-725
Si les stratégies qui se sont manifestées lors des ateliers populaires de mai 68 ne sont donc pas absentes du monde de l’art qui a suivi, leur combinaison et leur maintien dans le temps rencontrent en revanche de sérieux obstacles. Transformés par l’événement, en quête d’un style nouveau, les artistes de l’Atelier populaire sont eux aussi presque tous revenus à la peinture au début des années 1980, non sans avoir essayé auparavant de nombreuses autres formes d’engagement artistique et politique, y compris l’abandon de l’art et l’établissement à l’usine, comme pour Pierre Buraglio ou Jean-Pierre Pincemin[4]. L’histoire des ateliers populaires de mai a beau être passagère et sans doute anecdotique, elle n’en est pas moins annonciatrice des capacités de résistance du monde de l’art aux critiques de ses normes de fonctionnement habituelles.
Toutes les formes de critique, y compris les critiques féroces du microcosme et des institutions artistiques, (presque) tous les discours politiques radicaux[5], ont pu, depuis cinquante ans, trouver une place dans cet univers, à travers des œuvres ou des discours, dans les galeries, les biennales et les musées. L’art contemporain neutralise et récupère tous les contenus, faisant même – dans certaines conjonctures qu’il conviendrait de mieux circonscrire (les crises économiques et financières ?) – de la critique de la marchandise, du spectacle et du capitalisme, la marchandise artistique distinctive par excellence. Quant aux artistes qui tentent de disparaître en renonçant plus ou moins totalement à la matérialité ou à la trace, à la visibilité, à la signature (par l’anonymat ou l’hétéronymie), en affirmant leur caractère ready made, en abandonnant toute création voire en se suicidant[6], ils finissent eux aussi par occuper une niche dans l’espace et l’histoire de l’art contemporain.
Certains théoriciens ont vu dans ces évolutions le symptôme d’une mort des avant-gardes historiques qui avaient recherché le dépassement de l’art dans la construction de formes de vie émancipée. D’autres font de cet hyper-criticisme admis et inoffensif de l’art contemporain le corollaire de son hétéronomie grandissante et de sa sujétion définitive à l’économie et au capital[7]. Dans les deux dernières décennies, la place stratégique de l’art dans les industries de la finance, de la mode et du luxe a certainement renforcé ce sentiment. Beaucoup de protagonistes du monde de l’art partagent ces analyses tout en continuant à défendre leur milieu comme refuge au moins virtuel de la liberté d’expression et fabrique potentielle de formes de vie alternatives et de gestes inédits dans des configurations politiques où ces attitudes sont de plus en plus dévaluées, relativisées, réprimées, et face à l’art pour l’art qui domine encore et toujours la production artistique. Quoi qu’il en soit, l’art critique (de l’art, de l’économie, de la société, de la politique) est devenu, dans le dernier demi-siècle, un quartier fort bien établi du champ artistique. Faut-il, pour cela, désespérer des capacités des artistes à transformer les règles du jeu artistique ou bien à peser politiquement au-delà de leur univers ?
Bouleversements inédits et fragmentations de l’art

Robert Filiou, Optimistic Box n°1, 1968. © Marianne Filliou Paris, Centre Pompidou – Musée national d’art moderne – Centre de création industrielle Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Meguerditchian.
Avant de céder à la mélancolie et au pessimisme, il est utile de resserrer l’analyse sur son versant socio-économique. Le monde de l’art d’aujourd’hui, sa morphologie, sa place dans la société, n’ont rien à voir avec ce qu’elles étaient en 1968 où l’expression même d’« art contemporain » n’existait pas encore. On ne comprendrait pas l’intégration large et rapide des contenus et des formes critiques les plus divers dans l’art d’aujourd’hui sans remarquer l’extraordinaire extension démographique et géographique des univers artistiques depuis un demi-siècle. Le nombre d’artistes visuels a considérablement augmenté, tout comme celui des galeries, des biennales, des expositions et des musées, en même temps que les institutions de l’art s’internationalisaient[8]. La diversification de l’offre artistique, de ses thèmes, de ses formes et de ses tonalités, est une conséquence mécanique de la croissance de ces univers et de la compétition en leur sein. À cette explosion, bien plus vertigineuse dans les vingt dernières années que dans le siècle ayant précédé[9] – et dont on peine encore à prendre la mesure exacte –, a correspondu une hausse massive de la demande d’œuvres d’art et des montants de capitaux investis ou consommés dans les arts visuels.
Cette augmentation ultra-rapide de l’échelle du monde de l’art s’est accompagnée d’une multiplication des disciplines, des styles, des conventions, autrement dit d’une babelisation rampante. Dans chacun des sous-univers qui constituent donc aujourd’hui le continent éclaté de l’art contemporain, la société des artistes est extraordinairement stratifiée : le niveau de concentration des revenus et des réputations y est plus élevé que dans la plupart des autres professions, le taux de précarité économique et de pluriactivité également. Aux antipodes des sommets où circulent collectionneurs et artistes superstars, les marges et les lisières du marché se multiplient. Le ferment permanent de la critique en bénéficie ; galeristes et curateurs viennent y puiser. Car l’espace nouveau de l’art s’adosse à un système institutionnel en pleines métamorphoses par rapport à ce qu’il était il y a cinquante ans, lorsque le marchand et le critique occupaient ensemble le rôle central de construction des carrières et des notoriétés. À côté des musées et des maisons de vente, dont le nombre et l’importance augmente, les collectionneurs et les commissaires contribuent aussi à la production de la valeur esthétique et économique des œuvres. Loin d’être devenu ce monde unifié et lissé par le capitalisme et la marchandise, l’art contemporain, à travers son arraisonnement économique même, apparaît au contraire de plus en plus comme un espace différencié, fragmenté, stratifié : un tissu bigarré et rapiécé qui contient de nombreuses coutures et de multiples fractures.

Gianni Motti, Je vous avais dit que je n’allais pas très bien, Cimetière des Rois, Genève.
Traduction de l’inscription gaélique figurant sur la pierre funéraire de l’homme de spectacle irlandais Spike Milligan, mort en 2002. © Yann Forget / Wikimedia Commons
Paradoxe de la situation : ces frontières, entre artistes, entre artistes et institutions, entre espaces marchands et non marchands, offrent en principe beaucoup plus de prises qu’il n’en existait dans « les années 68 » pour développer un art qui interroge les normes de l’art ou qui s’oppose à elles. L’engagement politique direct des artistes ou les œuvres à contenu politique n’ont certes pas disparu : leur nombre, si ce n’est leur proportion, a certainement augmenté dans les dernières décennies. Mais à côté d’elles, un ensemble de stratégies tournées vers le monde de l’art lui-même déconstruisent ses fondements, complexifiant ainsi les relations de l’art et de la critique politique.
Résistances
On peut dire schématiquement que deux grandes traditions ont dominé la scène de cet art critique de l’art depuis un demi-siècle : l’art conceptuel et néo-conceptuel et la critique institutionnelle[10]. La première prétend résister à l’emprise de la valeur d’échange. La seconde dénonce ou, mieux, défait, les instruments de la valorisation. Avec la prolifération des intermédiaires de l’art, des formes nouvelles de critique institutionnelle à destination des commissaires, des centres d’art, des écoles (on a parlé d’educational turn) se développent, bien au-delà de celles qui portaient sur le seul musée et ses ramifications dans l’univers des multinationales ou des régimes autoritaires, comme c’était le cas dans les années 1970. Des agencements collectifs, comme les Nouveaux commanditaires en France, ont eu pour objectif de libérer les artistes au moins provisoirement de la contrainte marchande en intensifiant le lien de l’œuvre et du public[11]. D’autres résistances s’expriment par l’évanescence (performance, esthétique dite relationnelle) ou la dispersion (multiples, fanzines, ephemerae), par la cartographie ou par l’archive, par la simulation du marché ou du musée, etc. : à travers un ensemble de stratégies et de formes visant à restaurer ou à disséminer la valeur d’usage des œuvres et à diminuer, à retarder voire à recouvrir l’expression de leur valeur d’échange. Plutôt que de reconduire une vision molaire des limitations qu’impose le monde de l’art aux ambitions d’émancipation, comme en 1968, l’art critique de l’art, développe depuis quelques décennies des stratégies moléculaires, locales, enfouies dans les plis innombrables du milieu artistique.
Pour d’autres, la seule issue politique radicale des artistes n’est pas dans la critique du système artistique (dans l’espoir de le réformer, de le transformer) mais dans la sortie du monde de l’art, non pas pour disparaître cette fois, comme cela pouvait s’imaginer dans la période antérieure, pas non plus pour boycotter de grandes manifestations internationales (comme récemment les biennales d’Istanbul, de Saint-Pétersbourg, de Sydney, et de São Paulo, entre 2013 et 2015), mais pour opérer principalement dans d’autres univers sociaux – l’entreprise, la politique, les relations internationales, l’hôpital, l’école, les sciences et techniques, le numérique, etc. – avec les techniques critiques accumulées au fil de l’histoire par les artistes. Plutôt que de tourner l’ambition sociale de l’art vers l’art lui-même : transformer d’autres pratiques, dénaturaliser d’autres institutions. Plutôt que d’enquêter sur d’autres mondes et de les rendre visibles à l’intérieur des institutions artistiques : déplacer les pratiques de l’art contemporain sur des terrains qui lui sont étrangers, transformer le désir de défection en extériorité active, intensifier les contestations dans d’autres domaines que l’art[12].
Est-ce à ce prix que pourraient émerger des liaisons avec d’autres groupes sociaux, comparables à celles qu’imaginaient les artistes des ateliers populaires de mai 68 avec les étudiants, les ouvriers, les paysans ? Un paradigme théorique et politique unifiait toutes ces espérances, ainsi que les critiques venues du monde de l’art il y a cinquante ans : celui de l’anticapitalisme, et son corollaire, l’identification de l’artiste au travailleur (comme dans l’Art Workers Coalition fondée en 1969). Dans ce cadre de pensée, la critique locale des normes et des institutions artistiques restait indissociable d’une critique globale de l’exploitation économique. La thématique du précariat a fourni, ces dernières années, le matériau d’une réactivation de ce court-circuit entre politique de l’art et politique générale. Mais les résistances à son adoption restent fortes ; on peut douter qu’elle conquière les artistes et offre matière à création.
En cinquante ans, l’art critique n’est pas mort même s’il a sans doute relégué au rang d’élément esthétique ce qu’il conservait de messianisme révolutionnaire. Une leçon des ateliers populaires de mai 68 reste cependant bien vivante : lorsqu’il entend résister aux institutions marchandes tout en ouvrant de nouvelles possibilités politiques, l’art doit agir hors du monde de l’art.
[1] Philippe Artières, Éric de Chassey (dir.), Images en luttes. La culture visuelle de l’extrême-gauche en France (1968-1974), Paris, Beaux-Arts de Paris éditions, 2018.
[2] Pour un récit de ces événements, voir, entre autres, Jean-Louis Violeau, « L’expérience 68, peinture et architecture entre effacements et disparitions », dans Dominique Dammame, Boris Gobille, Frédérique Matonti, Bernard Pudal, Mai-Juin 1968, Éditions de l’Atelier, 2008, p. 222-233 ; Les affiches de mai 68, Beaux-Arts de Paris éditions / Musée des beaux-arts de Dole, 2008. Sur les liens entre théoriciens critiques français et figuration narrative, voir Sarah Wilson, Figurations ± 68 – Le monde visuel de la French Theory (2010), Les Presses du Réel, 2018.
[3] Sur le développement de ces stratégies d’autorité collective, voir notamment Blake Stimson, Gregory Sholette (eds.), Collectivism After Modernism, University of Minnesota Press, 2007 ; Jacopo Galimberti, Individuals against Individualism: Art Collectives in Western Europe (1956-1969), Liverpool University Press, 2017.
[4] Éric de Chassey, Après la fin. Suspensions et reprises de la peinture dans les années 1960 et 1970, Paris, Klincksieck, 2017.
[5] Il faudrait s’interroger sur l’existence (et sur ses modalités éventuelles) d’un art visuel contemporain d’extrême droite, ouvertement raciste ou néo-fasciste, comparable à ce qui existe en littérature ou dans le cinéma.
[6] Je me permets de renvoyer à Laurent Jeanpierre, « Faire de sa mort une œuvre d’art. Une pédagogie cynique ? », art press 2, 3, « Cynisme et art contemporain », nov.déc. janvier 2006-7, p. 16-27.
[7] Parmi de nombreux ouvrages développant de telles thèses, on retiendra l’un des derniers en date : Julian Stallabrass, Art Incorporated: The Story of Contemporary Art, Oxford University Press, 2004.
[8] Il faut ici renvoyer aux travaux pionniers de Raymonde Moulin, Le Marché de l’art. Mondialisation et nouvelles technologies, Paris, Flammarion, 2003.
[9] Clare McAndrew, Suhail Malik, Gerald Nestler, « Plotting the art market: An interview with Clare MCAndrew », Finance and Society, vol. 2, n°2, 2016, p. 151-167.
[10] Voir le bel essai d’Olivier Quintyn, Valences de l’avant-garde, Paris, Questions théoriques, coll. Saggio Casino piccolo, 2015.
[11] François Hers, Xavier Douroux, L’art sans le capitalisme, Dijon, Les presses du réel, 2011.
[12] Le cadre de cet article ne permet pas de discuter plus avant les propositions bien plus détaillées allant dans une direction semblable in Gregory Sholette, Dark Matter. Art and Politics in the Age of Enterprise Culture, London, Pluto Press, 2011.
(Image en une : Christoph Büchel, Dump, Vue de l’exposition « Superdome », Palais de Tokyo, Paris, 2008. Photo : Didier Barroso. Courtesy Christoph Büchel ; Hauser & Wirth Zürich, Londres).
articles liés
Paris noir
par Salomé Schlappi
Du blanc sur la carte
par Guillaume Gesvret
« Toucher l’insensé »
par Juliette Belleret