Calla Henkel & Max Pitegoff

Calla Henkel et Max Pitegoff : « La fiction consiste à donner un sens à ce que nous ne pouvons contrôler. »
La capacité de stockage de nos téléphones explose. Trop d’images floues, de notes éparses, de captures d’écran que l’on ne regardera pas. Alors, on paye pour un forfait de stockage supérieur et on se contente de passer à autre chose. Tous ces pense-bêtes empêchent de saisir et de sentir clairement une cohérence, une progression, peut-être même une émotion enfouie, voire une direction qui ferait sens. On dit souvent que l’histoire s’accélère et file le tournis, mais peut-être est-ce simplement notre mémoire externalisée qui, de plus en plus souvent, déraille.
Depuis une quinzaine d’années, le duo d’artistes Calla Henkel et Max Pitegoff mène une œuvre personnelle, perspicace et généreuse autour de ces enjeux terriblement actuels : la documentation, la mémoire, l’industrie de la tech et les pratiques collectives. Né·es respectivement en 1988 et en 1987 aux États-Unis, les artistes fondent des lieux d’échange fonctionnels pour leurs pairs d’où sourdent des récits et des ragots qui finissent par se solidifier en textes, pièces de théâtre ou films. À Berlin, où ils s’expatrient en 2009, ces structures ont pris la forme du bar illégal Times Bar (cofondé avec l’artiste Lindsay Lawson, 2011-2012), du théâtre amateur New Theater (2013-2015) ou encore du second bar et plateau de tournage TV Bar (2019-2022).
Alors que les années 20 s’amorçaient poussivement, le duo retraversait l’Atlantique. Calla Henkel devenait l’autrice de deux romans à succès, Other People’s Clothes (2021) [traduit en français1] et Scrap (2024), que la plupart avaleront comme des thrillers haletants, et qu’une poignée d’autres avalera comme les récits possibles d’une certaine scène artistique berlinoise observée de l’intérieur. Depuis 2024, Calla Henkel et Max Pitegoff gèrent le théâtre New Theater Hollywood à Los Angeles, tandis que leur première monographie German Theater 2010-20222 a vu le jour un peu plus tôt cette même année. Ils reviennent avec nous sur la genèse et les enjeux de leur pratique. Peut-être, alors, est-ce notre rapport à la fiction plutôt qu’aux faits qui est à réévaluer.

Times Bar, 2012.
Courtesy the artists and Galerie
Isabella Bortolozzi, Berlin.

Times Bar, 2012.
Courtesy the artists and Galerie
Isabella Bortolozzi, Berlin.
Vous vous êtes rencontré·es lorsque vous étiez étudiant·es à Cooper Union à New York. Quelle était alors votre pratique et comment avez-vous décidé de travailler en duo ?
Max Pitegoff – Nous avons commencé à travailler ensemble par la photographie et c’est resté un fil rouge de notre pratique. Nous partagions un intérêt pour la performance, son aspect social et sa documentation en particulier : comment capturer quelque chose sans que cela se réduise à l’image unique et aléatoire qui reste après un événement ? Lorsque nous étions étudiant·es, nous partagions un appareil photo, cette pratique rendait incertain·e l’identité de l’auteur·ice du cliché. Ensuite, nous avons commencé à développer nos propres performances et nous les avons documentées.
Étudier à Cooper Union a modelé notre relation à la collaboration. On y percevait les ombres portées d’autres collectifs d’artistes et de leurs manières de travailler. Par exemple, les membres de Bruce High Quality Foundation [formé en 2004] avaient été étudiant·es à l’école cinq ans avant nous environ et connaissaient un grand succès marchand au moment où nous y étions. De nombreux ami·es ont été embauché·es par leur studio immédiatement après leur diplôme. Dix ans plus tôt, il y avait eu Art Club 2000 [1992-1999], et Patterson Beckwith avait été l’un de nos premiers professeurs de photographie. Doug Ashford, qui avait fait partie de Group Material [1979-1996] avec Julie Ault et Félix González-Torres, était aussi l’un de nos enseignants. C’était dans l’air du temps et cela a préparé le terrain pour nous. On nous apprenait le langage du travail en collectif et, simultanément, nous en développions notre propre version.
Calla est partie étudier à l’étranger à Berlin. Après avoir connu le New York financiarisé du milieu des années 2000, Berlin se présentait comme une alternative. C’était en 2009, et il y régnait un sentiment utopique. C’était un endroit où les gens avaient le temps d’expérimenter, de traîner tard la nuit et donc de rejoindre nos performances sociales de grande envergure.
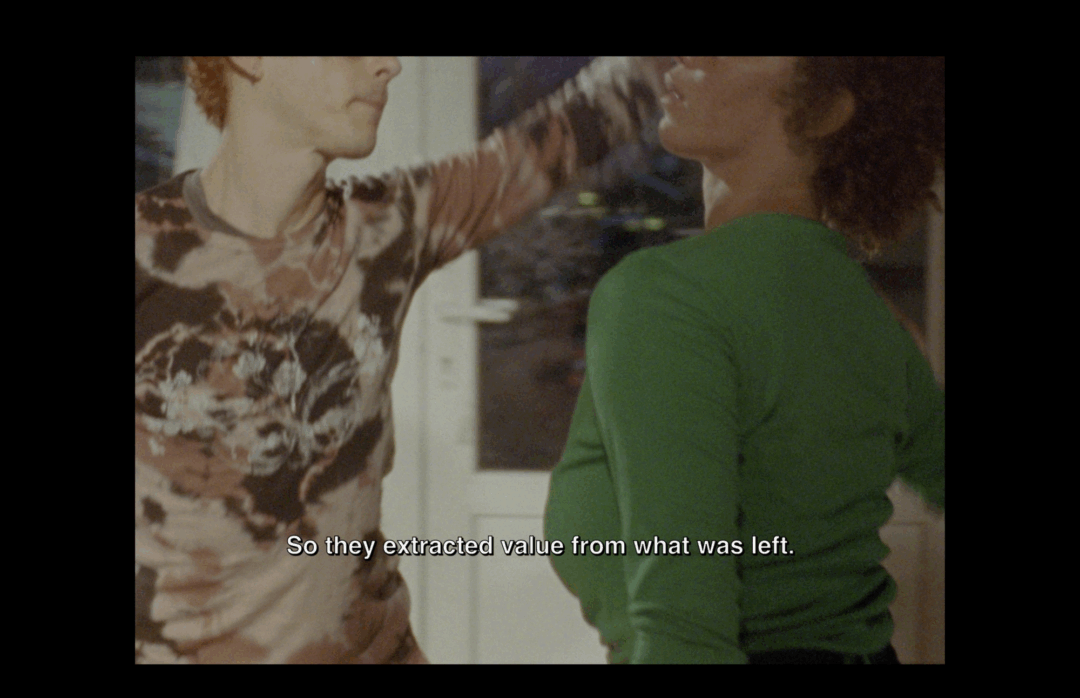
Extraits du film / Film stills. Courtesy the artists, Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin and Cabinet, London.
À partir de quel moment vos structures collectives comme les bars, les théâtres ou le plateau de tournage télévisuel ont-elles commencé à fonctionner comme des « machines narratives », ainsi que vous les avez qualifiées ?
Calla Henkel – Nous avons assez rapidement adopté l’état d’esprit de Berlin concernant la photographie. La ville possède historiquement une politique exceptionnelle d’interdiction de photographier dans les clubs. C’est en partie une forme de protection de la vie privée et de l’hédonisme, mais cela a également créé une abstraction intéressante de la vie nocturne. À Times Bar, nous avons donc commencé à ne photographier le lieu que de jour, que ce soient les vestiges d’un événement ou les œuvres qui avaient été installées au-dessus du bar. Puis, nous avons lentement commencé à consigner certaines choses dans des livres de comptes, comme les ardoises des client·es, et c’est devenu de plus en plus baroque au fil des mois ; nous les appelions les « livres des additions ». Au début, il s’agissait simplement d’enregistrer qui nous devait quoi, puis nous avons commencé à nous servir de ces informations pour résumer les soirées (qui était là, etc.) et, finalement, pour enregistrer les citations des un·es et des autres.
Nous avons réalisé que les livres d’additions ressemblaient aux Kammerspiel ou théâtres de chambre – une forme de pièce de théâtre allemande intimiste –, car ils étaient proches d’une sitcom : tous·tes les personnages réapparaissaient et tous·tes étaient enfermé·es dans une boîte, pleine d’alcool. Chaque nuit était son propre drame. Les livres d’additions ont fourni l’ébauche des scripts que nous allions bientôt écrire ; après tout, le bar est une scène de théâtre idéale. Nous étions derrière le comptoir chaque nuit, et nous savions que nous y livrions une performance. Tout le monde faisait le show. La scène se dérobait en permanence. Nous avons pris ces idées et nous les avons mises en application en ouvrant un théâtre [New Theater] un an plus tard.
MP – Après la crise financière de 2008, nous réfléchissions beaucoup aux fictions partagées – dans le monde financier et au-delà. Nous étions également les témoins d’une certaine époque à Times Bar en 2011-2012, lorsque tous·tes les ancien·nes étudiant·es de la Städelschule déménageaient de Francfort à Berlin et lançaient leur carrière. Lindsay [Lawson, une artiste américaine basée à Berlin et la cofondatrice de Times Bar] venait d’être diplômée de l’école, donc tous·tes les autres nouveaux·elles diplômé·es y venaient pour se faire un réseau : une performance que nous observions se dérouler en étant derrière le bar.
CH – Oui, il y avait une ruée vers l’or du post-Internet à ce moment dans la ville.
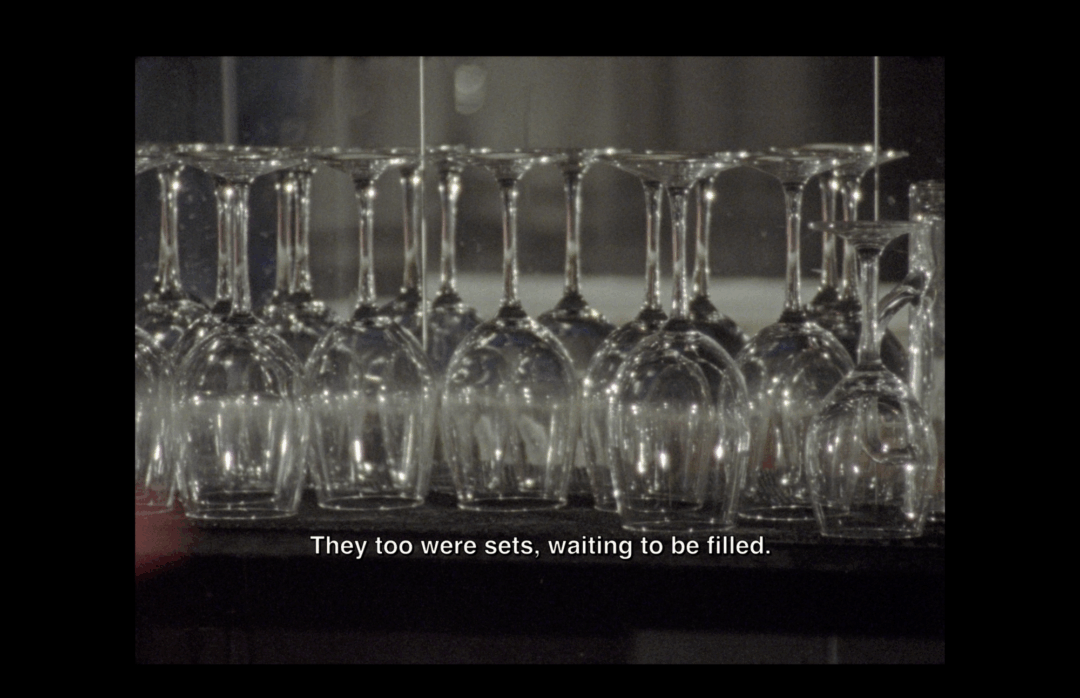
Extraits du film / Film stills. Courtesy the artists, Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin and Cabinet, London.
La gentrification fait rapidement surface dans votre travail. C’est le cas dans votre pratique en duo et par la suite dans le premier roman de Calla, Other People’s Clothes. Comment en avez-vous pris conscience et quel impact cela a-t-il eu sur la scène artistique ?
CH – Nous avons toujours été intéressé·es par le fait que l’on accuse les artistes d’être responsables de la gentrification. Pour moi, ce substitut est absurde. Ces vastes changements sont le plus souvent de la responsabilité des politiques gouvernementales, qui transfèrent la faute sur les artistes – avec l’idée du loft d’artistes, par exemple. Entre le moment où nous avons ouvert Times Bar et ensuite New Theater, la ville s’était transformée très rapidement. L’autre face de l’art Internet était l’industrie de la tech ; nous l’avons vraiment vue venir. À Berlin, la tragédie était majoritairement un coup monté : Angela Merkel voulait transformer la ville en paradis de la tech.
MP – Nous l’avions déjà vu, nous avions vu la fin de ce processus dans l’East Village avec nos enseignant·es qui possédaient des lofts à Soho qu’ils avaient achetés dans les années 1980. Lorsque nous en avons vu une version se reproduire à Berlin, nous y étions donc sensibles. Times Bar était un bar d’artistes anglophones à Neukölln, un quartier où il n’y avait pas encore beaucoup d’espaces de ce genre. Cela voulait dire que, dès le départ, nous nous posions la question de savoir quelles en étaient les véritables forces motrices.
CH – Le rôle de l’artiste dans la gentrification a influencé une grande partie de notre travail. Nous nous intéressions aux systèmes. Les obligations fiscales pour les travailleur·euses freelance. Le processus des visas de l’Ausländerbehörde [bureau de l’immigration allemand] qui avait autrefois été très favorable aux artistes, mais qui commençait à privilégier les travailleur·euses de la tech. Nous y étions très sensibles et nous en avions peur, mais nous en faisions inévitablement partie aussi, donc une grande partie du travail que nous menions à l’époque se concentrait sur la façon d’exister au sein d’un tel système.
Quelle est votre relation à la vérité et à l’authenticité à l’ère numérique ? La fiction peut-elle devenir un document sincère lorsque l’accès aux faits est de plus en plus incertain ?
CH – Parce que nous entretenions cette relation à la documentation et à la performance, nous avons appris très tôt que l’archive n’est jamais vraie, qu’elle devient sa propre version fictionnelle ; elle n’existe pas en elle-même. Nous étions obsédé·es par la manière dont, dans les années 1980 et au début des années 1990, une seule photographie d’une certaine danse de Martha Graham en devenait la représentation. C’est une fiction. L’une des œuvres qui a totalement changé notre façon de penser quant à l’acceptation de la séparation entre la vérité et la documentation a été le documentaire fictionnalisé de Charles Atlas sur la compagnie de danse de Michael Clark, All Hail the New Puritain (1986). Ça a été un moment de déclic.
Je pense que toute performance est transformée en iconographie et en mémoire collective. La mémoire collective était ce qui nous intéressait le plus, car c’est elle qui se rapproche probablement le mieux de la matière avec laquelle nous travaillons actuellement. Pour nous, il s’agit de décider en temps réel laquelle constituera la nôtre. Ce faisant, un certain type de manipulation entre bien sûr en jeu, mais cette version est aussi uniquement la nôtre ; elle ne sera jamais véritablement collective. Cela nous a pris un certain temps avant d’acquérir au sein de notre pratique la confiance et la sincérité nécessaires pour travailler cette question délicate.
MP – Je pense que sincérité est le bon mot. La fiction peut en contenir tellement, et cette version fabriquée de la redite transmet, malgré tout, la vérité.
CH – Nous tournons beaucoup en ce moment pour documenter notre espace actuel et ses potentiels changements au sein d’un cadre narratif. Par exemple, le bâtiment a été peint en rouge et, récemment, un·e acteur·ice a déménagé – ces accrocs, qui auraient pu créer des ruptures dans la continuité, nous les incluons à présent dans l’écriture. Nous pouvons expliquer ces changements par la fiction. Nous pouvons dire qu’un riche mécène a payé pour que le théâtre soit repeint. Nous pouvons dire que l’acteur·ice manquant·e a finalement « réussi » et tourne un film à Atlanta. Tout cela nous permet d’utiliser le caractère imprédictible de la réalité. Nous ne pouvions jamais contrôler ce qui allait se passer chaque nuit au bar ; de même, nous ne pouvons pas maîtriser qui achète les billets pour nos pièces de théâtre. La fiction, pour nous, c’est faire sens avec ce que nous ne pouvons pas contrôler.
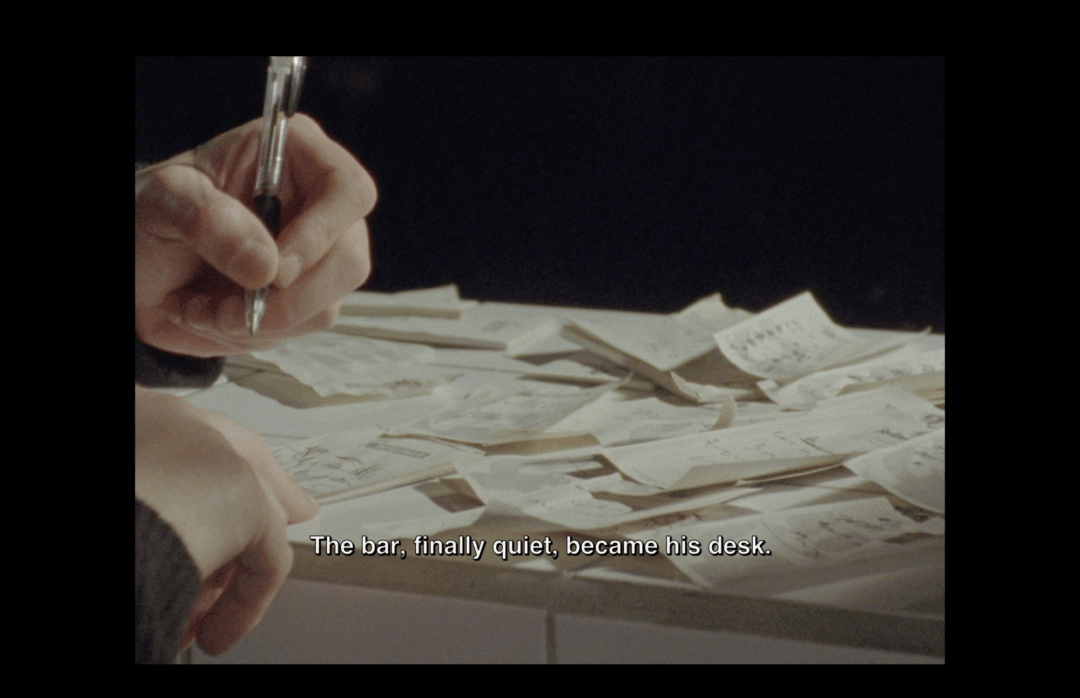
Extraits du film / Film stills. Courtesy the artists, Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin and Cabinet, London.
Calla, la même logique entre-t-elle en jeu lorsque vous écrivez vos romans ? Cela y ressemble beaucoup dans la manière de choisir un médium pour donner une version de certains événements…
CH – J’ai écrit mon premier roman après la fin de notre projet à la Volksbühne [en 2018]. Max et moi en avions tellement marre du théâtre que nous avons eu besoin de faire une pause. Je suis rentrée chez mes parents et j’ai commencé à me demander comment j’avais bien pu finir à Berlin. Max et moi avions passé une décennie tellement intense. J’ai juste commencé à écrire ; n’écrire que pour moi-même, cet égoïsme m’a soulagée. Après des années à écrire du théâtre de niche, je voulais écrire quelque chose que n’importe qui pourrait lire. J’ai donc opté pour un thriller. Le travail que Max et moi menons traite de la réalité et des autres avec une sincérité tellement chargée que cela engendre aussi une certaine pesanteur. Dans notre travail en duo, nous devons faire très attention et rester très attentif·ves, car il implique d’autres personnes, d’autres pratiques et d’autres conversations. Nous devons procéder avec lenteur et réflexion. Avec les romans, j’ai le droit de simplement me trouver à bord de ma propre voiture de course – aussi absurde que la métaphore puisse paraître – et d’inventer des choses.
MP – La forme littéraire est très intéressante. Vous pouvez vous enfoncer dans des impasses narratives dont vous devez ensuite trouver la sortie. D’une certaine manière, vous vous creusez la mémoire pour cela.
CH – Absolument. Dans le format du thriller, il doit y avoir une réponse à la fin, tandis que dans notre travail d’artistes, nous n’en fournissons jamais ; il y a seulement davantage de questions qui nous dirigent plus profondément vers le cœur de ce que nous cherchons. Cela ne rend pas les thrillers jetables, mais ce sont des mondes clos. Les questions sur lesquelles Max et moi avons travaillé continuent de changer et d’évoluer ; notre travail est cependant très rigoureux.
MP – Avant que Calla ne commence à écrire son roman, nous avons exposé à Rotterdam au Kunstinstituut Melly3 (autrefois appelé Witte de With). L’exposition traitait des idées auxquelles nous réfléchissions à l’époque autour de la fiction. Nous avions rédigé un texte sur la relation que notre pratique entretient avec la fiction4 – à partir d’une étude du groupe d’artistes K-HOLE qui prédit des tendances.
CH – Paradise, le film que nous avons tourné à TV Bar, s’appuie sur Huit heures ne font pas un jour (1972-1973) de Rainer Werner Fassbinder. Nous voulions que notre film parle des employé·es du bar qui décident de le reprendre à cause d’un·e chef·fe absent·e. Dans la vraie vie, Max et moi voulions aussi céder le bar à nos employé·es, mais le bâtiment a été vendu et notre contrat de location n’a pas été renouvelé. Cela a dicté la fin du film : dans la scène finale, plein de gens en costume entrent dans le bar et s’emparent du bâtiment. Ce n’est pas comme si c’était une histoire décidée par un jury ou un comité ; c’est une histoire dictée par la réalité, par la tentative de faire exister ce qui nous influence ; cela donne les clés de compréhension d’une grande partie de notre travail.
- Calla Henkel, Toxic Berlin, trad. Rémi Boiteux, Paris, Les Arènes, 2023.
- Fabrice Stroun (dir.), Calla Henkel & Max Pitegoff. German Theater 2010-2022, Bruxelles, Rile Books, 2024.
- Calla Henkel & Max Pitegoff, « Foreword », cur. Defne Ayas et Natasha Hoare, Rotterdam, Kunstinstituut Melly, 2016.
- Calla Henkel & Max Pitegoff, « Political Populism », Zérodeux, no 77, printemps 2016.

Head image : Calla Henkel and Max Pitegoff, Hotel Moon, New Theater, Mars / March 2015.
Avec les peintures de / With paintings by Birgit Megerle, bandstand by Grayson Revoir, posters de / by Alex Turgeon, plantes de / plants by Georgia Gray, et l’escalier de / and staircase by Ellie de Verdier. Photo : Calla Henkel & Max Pitegoff. Courtesy the artists and Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin.
- Partage : ,
- Du même auteur : Dena Yago, Geert Lovink : « Pas une seule génération ne s’est élevée contre Zuckerberg », Émilie Brout & Maxime Marion, CLEARING, Hanne Lippard,
articles liés
Céline Poulin
par Clémence Agnez
Dena Yago
par Ingrid Luquet-Gad
Céline Ghisleri
par Juliette Belleret