Hanne Lippard

KW, Berlin, 20.01—9.04.2017
« Je ne suis certainement pas un poète, je suis un piètre écrivain, c’est probablement pour cela que je parle de communication orale. Je ne suis pas poète et j’envisage la communication orale comme une sculpture. ». Cette déclaration, on la doit à un artiste qui a fait de la discussion son médium de prédilection, attaché à générer des situations que l’on ne pourrait expérimenter par procuration. Dès le mitan des années 1960, le sud-africain Ian Wilson (car non, Tino Sehgal n’a pas le monopole de la présence) a décidé de délaisser définitivement les brosses et le châssis qui avaient accompagné ses premières années d’activité. Comme les conceptuels new-yorkais dont il est proche, fréquentant la bande de Joseph Kosuth, Robert Barry ou Lawrence Weiner, la dématérialisation chassera progressivement tout attachement à la forme dans son œuvre. Pour lui, même l’écriture reste encore trop tributaire d’une enveloppe matérielle, qui la fige dans une temporalité dissymétrique entre la création d’un sens et sa bonne réception a posteriori. Son art, déclarera-t-il alors, sera « information et communication », il sera dialogue et co-création. Dès 1968, son protocole de travail est en place. En témoigne Time (spoken), encore à ce jour l’une de ses œuvres les plus connues. Lors des vernissages de ses expositions, l’œuvre se construira au fur et à mesure qu’il passe entre les visiteur et désamorce leurs pépiements mondains, répondant systématiquement par le mot « temps » lorsqu’on lui demande quel est le sujet de l’exposition ou la teneur de ses recherches du moment. De ces échanges ne restera aucune trace physique, l’enregistrement étant formellement prohibé, mais uniquement des survivances mnésiques.

De gauche à droite : Hanne Lippard, Flesh, 2016. Courtesy Hanne Lippard ; LambdaLambdaLambda, Prishtina. Ian Wilson, Time (spoken), 1982. Vue d’installation KW Institute for Contemporary Art, Berlin, 2017. Photo: Frank Sperling.
Ian Wilson, pourrait-on dire, c’est Tino Sehgal sans le battage médiatique. Mais ce qui différencie la portée de leurs œuvres ne tient pas tant à leurs intentions et démarches intrinsèques, sensiblement identiques, qu’au contexte culturel dans lequel elles prennent place et qui en conditionnent l’appréhension. Nés respectivement en 1940 et en 1976, une génération les sépare. De fait, par ses « sculptures sociales », Ian Wilson réalise une démarche inclusive : désormais, l’œuvre peut être réalisée par tout le monde et, de fait, sa condition d’existence même dépend de cette pluralité. L’interdiction de documenter le processus apparaît alors simplement comme une manière de ne pas reconduire la position d’auteur en la transférant à celui qui détient l’archive, artiste ou institution. Au contraire, Tino Sehgal, lorsqu’il commence à produire ses premières situations au début des années 2000, est perçu comme faisant un acte de retrait critique, construisant son œuvre sur un état de fait devenu depuis établi, la maladie de l’archivite des institutions(« archival impulse », dira plus sobrement Hal Foster) et surtout des prémisses de la documentation effrénée de la part d’un public qui mutera en l’« homo instagramus » que l’on sait.

Ian Wilson, A discussion in context of an exhibition, March 8, 9 and 10, 1978, Galerie Rüdiger Schöttle, Munich. KW Institute for Contemporary Art, Berlin, 2017. Photo: Frank Sperling.
La voix, médium le plus immédiat qu’il soit donné à l’humain pour faire œuvre, est donc loin d’être dénuée d’histoire. Ce fait, le KW Berlin – et son nouveau directeur Krist Gruijthuijsens – nous le rappelle en faisant dialoguer deux artistes travaillant chacun depuis leur contexte médiatique sur l’oralité : Ian Wilson donc, et Hanne Lippard. Pour sa première exposition institutionnelle, la jeune artiste norvégienne, née pour sa part en 1984, présente Flesh, un environnement d’écoute immersif qui fait hésiter entre les qualificatifs de bureaucratique et d’utérin. Sous un plafond rabaissé d’un petit mètre soixante-dix auquel on accède par un escalier en colimaçon beigeasse, un espace exigu tapissé de rose chair accueille deux enceintes. Nous en provient par intermittence le phrasé monotone, hypnagogique et synthétique caractéristique des performances de l’artiste, déclamant une poésie hyper-réelle dont seuls quelques éléments discordants – une trace d’accent nordique dans l’anglais globalisé d’aéroport, une lettre à dessein trop accentuée – nous indiquent que nous ne sommes pas en train d’assister à un récital de Siri.
Graphiste de formation, Hanne Lippard a elle aussi fait le choix de travailler exclusivement avec la voix, et la sienne uniquement, pour médium. Mais chez elle, face à l’inéluctabilité de l’enregistrement sauvage, la question de la voix se conçoit au contraire comme une manière d’échapper aux dictats de la nouvelle économie de la présence, cette « tyrannie de l’être-là » pointée avec justesse par Hito Steyerl, identifiant l’expérience authentique comme la valeur la plus vendable de l’art contemporain actuel[1]. Pour Lippard[2], l’oralité se détache de la présence et permet au contraire, par l’écoute individuelle et en mouvement dans ses écouteurs, de reconduire l’accessibilité à la source des expérimentations d’Ian Wilson, sans pour autant donner dans la fétichisation de la co-présence qui, en dernier recours, revient précisément à redonner à l’institution le pouvoir de validation auquel il s’agissait d’échapper en liquidant le contenant matériel de l’idée.
Vous êtes de ces artistes qui ont juré fidélité à un seul médium. Comment avez-vous décidé de travailler autour de la voix ?

Hanne Lippard, Flesh, 2016. KW Institute for Contemporary Art, Berlin. Courtesy Hanne Lippard ; LambdaLambdaLambda, Prishtina. Photo: Frank Sperling.
J’ai toujours nourri un intérêt pour le texte. Lorsque j’étais enfant, je voulais devenir écrivain ou journaliste. J’ai finalement opté pour des études de design graphique à la Gerrit Rietveld Academie aux Pays-Bas afin de pouvoir inclure un aspect visuel à la textualité. L’approche de l’école est très conceptuelle mais ce qui m’a le plus marquée, et dont on retrouve encore aujourd’hui la trace dans la manière dont je conçois mes performances, c’est l’aspect physique de manipulation du texte – une manière de revenir à une approche assez primitive, presque en deçà du stade de l’alphabétisation. Travailler la typographie m’a permis de découvrir l’aspect rythmique du texte mais il me manquait un aspect plus personnel et incarné. Mes premières tentatives autour de la voix découlaient de cette envie de renouer avec l’imprévu et l’interprétation de la performance.
Si la langue est rendue malléable, que ce soit par la typographie ou par l’oralisation, transformée pour reprendre la terminologie de Ferdinand de Saussure en « image acoustique », quel rôle joue la narration dans vos pièces ?
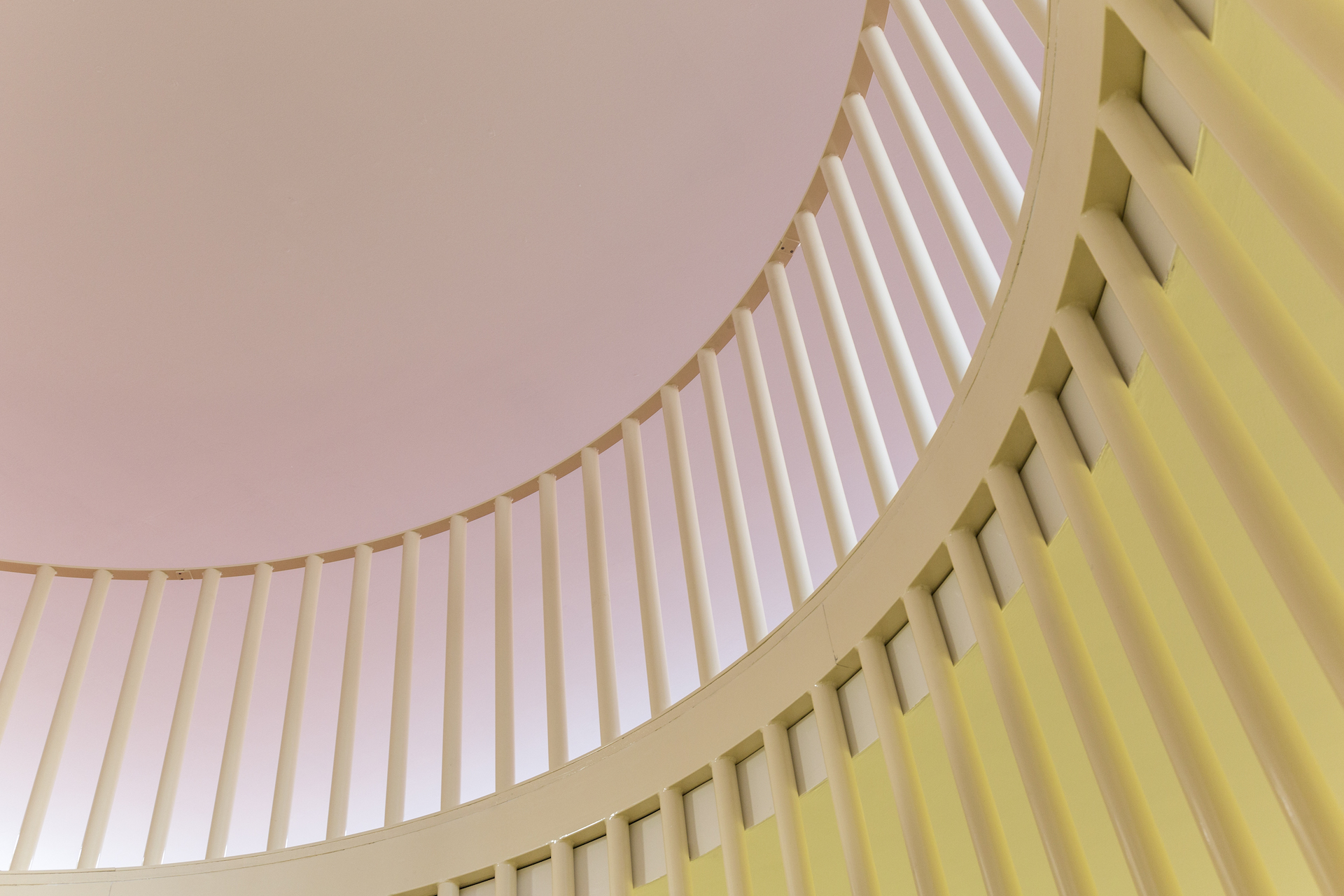
Hanne Lippard, Flesh, 2016. KW Institute for Contemporary Art, Berlin. Courtesy Hanne Lippard ; LambdaLambdaLambda, Prishtina. Photo: Frank Sperling.
Mon processus d’écriture se construit presque toujours autour d’éléments de langage trouvés. Je pars en général d’une phrase ou d’un slogan glané dans l’environnement quotidien. La standardisation du langage et les phénomènes de répétition, de déclinaison en série et de variation autour d’un même thème m’intéressent. Ainsi, l’une de mes premières pièces s’intitulait Beige[1]. Je partais cette fois d’une répétition visuelle de cette couleur sans qualité, typique d’espaces globalisés conçus pour pouvoir être répliqués à l’identique à l’échelle globale. À ce moment, j’avais vingt-cinq ans et je réalisais que je commençais moi-même à vouloir m’habiller de manière plus adulte pour me fondre dans le moule, en choisissant des couleurs neutres, chic et monotones. Un hasard a fait que des chercheurs ont identifié au même moment que la couleur moyenne de l’univers serait également une teinte de beige clair, assez décevante, appelée Cosmic Latte. De fait, la pièce relie ces éléments par un jeu d’échos et de rebonds sur un ton neutre que l’on retrouve dans la plupart de mes pièces. Comme je suis toujours celle qui les interprète et que j’utilise la première personne dans la narration, il est presque impossible de ne pas y voir une histoire. C’est un mécanisme d’identification bien connu des fabricants de programmes vocaux utilisés pour les assistants personnels ou les chatbots. Ces voix synthétiques ne sont pas neutres mais imitent systématiquement une voix féminine, puisqu’elles vont susciter chez l’auditeur un réflexe instinctif d’identification et de confiance. En retour, je m’intéresse beaucoup au phrasé d’applications comme Siri, la voix des téléphones Apple, ou encore à la diction que l’on retrouve à travers les différents tutoriels sur Youtube, un vrai genre en soi.
Vous lisez systématiquement vos textes vous-même. Avez-vous déjà envisagé de faire appel à un autre interprète ?
Au début oui, mais j’avais l’impression de déléguer une partie essentielle de mon travail, qui se situe tout autant dans la lecture, que j’identifie au travail de modelage ou de sculpture, que dans l’écriture préliminaire. J’écris en gardant à l’esprit une certaine qualité de prononciation : au fil des pièces, il y a une certaine diction qui est devenue récurrente et qui, comme nous l’évoquions, découle également d’un travail de collage et de sampling purement sonore des manières de dire qui se développent sur Internet. Par ailleurs, mes pièces sont forcément en anglais, quel que soit le contexte de monstration, bien que j’aie grandi bilingue en parlant à la fois anglais et norvégien, et que je réside actuellement à Berlin. Mais précisément à cause de cette facilité à passer d’une langue à l’autre, j’ai élaboré un anglais globalisé qui n’est pas un anglais académique mais un anglais propre aux pubs et aux manuels de marketing, et que je crois accessible et compréhensible par tous.
Avec le développement des outils de contrôle vocal précédemment évoqués, évolution que retrace Nicolas Santolaria dans son livre Dis Siri paru à la rentrée, pensez-vous que l’oralité fasse retour au sein de la « galaxie Gutenberg » qui l’avait refoulée ?
On m’a raconté qu’il était aujourd’hui courant pour les adolescents de dicter leurs messages au lieu de les écrire, dépassés par la prolifération des applications de messagerie écrite. Cependant, je ne pense pas que l’on puisse vraiment revenir à une civilisation orale. Le théoricien des médias Walter J. Ong l’explique très clairement dans son ouvrage de référence Oralité et écriture. La technologie de la parole, où il explique qu’à moins qu’une catastrophe nucléaire n’éradique totalement la vie humaine, nous ne reviendrons jamais à une oralité primaire. En revanche, il se pourrait effectivement que nous assistions à l’avènement d’une oralité secondaire, c’est-à-dire consciente de la culture de l’écrit. Mon travail se situe à ce point, puisque je garde toujours la conscience du mot imprimé – et d’autant plus par ma formation de graphiste. Ce qui m’intéresse, c’est justement le processus pour ainsi dire inversé de retraduire le texte écrit en langage oral, avec tous les accidents qui peuvent venir interférer dans le processus et empêcher une communication limpide. L’une de mes œuvres, The Ssecret to SsucceSs iSs in the Ss-eSs traite de ces perturbations : j’ai quasiment repris tel quel le texte d’un manuel de développement personnel américain qui explique comment monter sa start-up, que je lis en accentuant un peu trop les « s », créant à la longue une imperceptible sensation d’inconfort alors que le texte reste extrêmement positif et encourageant.
Comment exposez-vous vos performances, notamment lors d’une manifestation de grande envergure comme celle que vous consacre actuellement le KW à Berlin ?
J’ai commencé par la performance de manière très naturelle – et aussi parce que pour un jeune artiste, c’est un médium peu onéreux et facilement transportable ! Mais ces deux ou trois dernières années, j’ai commencé à me poser la question de l’environnement dans lequel je présentais mes œuvres. Pour moi, il s’agit surtout de savoir comment tenir compte de l’attention distraite des spectateur : est-ce que l’on créée un dispositif pour y pallier ou bien est-ce que l’on accepte cette donne ? Au KW, dans l’espace qui a été construit pour présenter l’enregistrement, seulement vingt personnes peuvent rentrer à la fois. En même temps, j’ai choisi de garder un temps de silence important entre les pièces sonores pour ne pas capturer l’attention de force, mais garder la qualité d’écoute flottante d’un environnement naturel, ou d’autres voix viennent se superposer à la pièce en tant que telle. À un moment donné, la question de la documentation et de l’archivage des œuvres s’est naturellement posée. Très vite, dès les premières performances, il a été clair pour moi que je ne voulais surtout pas fétichiser la présence, même en travaillant un média temporel. Le visionnage sur ordinateur fait partie intégrante des modes d’accès possibles à la pièce. C’est le cas chez la plupart des artistes de ma génération, et par rapport à la position d’interdiction de documenter qui est celle de Tino Sehgal, il me semble qu’elle relève tout simplement du paradigme d’une autre génération que la mienne. Lorsque j’ai fait mes toutes premières performances, il y a toujours eu quelqu’un qui filmait avec son téléphone. La réception de mes œuvres se base sur l’impact sensoriel du contact avec un autre corps, à l’intersection entre l’abstraction du texte et l’incarnation par la voix et ses imperfections. Mais pour nous, qui n’avons pas encore appris à faire vraiment la part entre voix organique et synthétique, la résonance affective sera là de toute manière, que la voix soit expérimentée en live, sur les enceintes de bonne qualité d’une institution ou chez soi devant son ordinateur. Si le personnage du film Her de Spike Jonze tombe amoureux de la voix d’un programme informatique, je pense que je peux tout à fait me satisfaire de ce que l’on visionne mes performances sur son ordinateur !
[1] Hito Steyerl, « The Terror of Total Dasein » http://dismagazine.com/discussion/78352/the-terror-of-total-dasein-hito-steyerl/ « the contemporary economy of art relies more on presence than on traditional ideas of labour power tied to the production of objects »
[2] … elle s’amusera de son homonymie avec la grande prêtresse de la dématérialisation et réalisera une pièce intitulée « Luci Lippard » https://vimeo.com/149143638
[3] https://vimeo.com/79293677
(Image en une : Hanne Lippard, Flesh, 2016. KW Institute for Contemporary Art, Berlin. Courtesy Hanne Lippard ; LambdaLambdaLambda, Prishtina. Photo: Frank Sperling.)
- Publié dans le numéro : 81
- Partage : ,
- Du même auteur : Geert Lovink : « Pas une seule génération ne s’est élevée contre Zuckerberg », Émilie Brout & Maxime Marion, CLEARING, Nicolas Bourriaud, Mark Alizart,
articles liés
Céline Ghisleri
par Juliette Belleret
Claire Staebler
par Patrice Joly
Arnaud Dezoteux
par Clémence Agnez


