Alain Badiou et le néoclassicisme
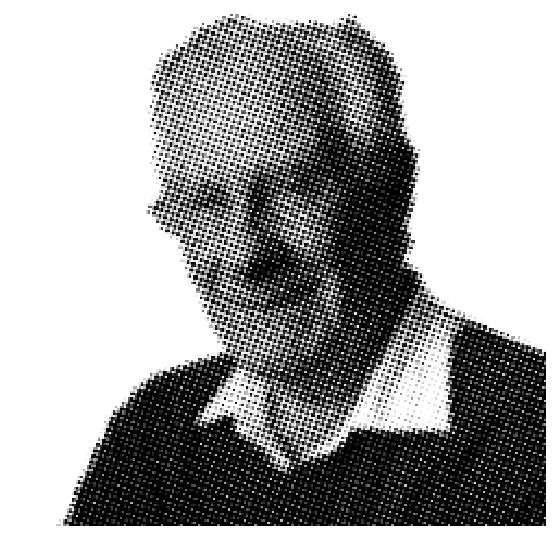
S’il ne fallait retenir qu’un nom illustrant ce qui s’est fait d’important dans le monde de la pensée ces dix dernières années, Alain Badiou pourrait être celui là. Depuis la parution du deuxième tome de l’Etre et l’Evénement, Logiques des mondes, il est admis qu’il a « fait œuvre » dans la métaphysique comme jamais avant lui depuis Heidegger. Avec De quoi Sarkozy est-il le nom ?, il a, de surcroît, conquis un grand public que seul un Sartre avait peut-être réussi à interpeller de la sorte, au point d’être invité à être le rédacteur en chef, pour un jour, de Libération. Mais Badiou, qui ne manque pas une occasion de polémiquer (sur Israël, sur l’homosexualité, sur la démocratie…), prête aussi le flanc à la critique, et d’autant plus vivement qu’il assume une position intellectuelle d’une prétention considérable (son système exposant, comme il se doit, rien moins que la vérité en soi et pour soi). Antisémite ou staliniens pour les uns, dogmatique voire mystique pour les autres, l’auteur de Saint Paul, Circonstances, Le Siècle, s’attire ainsi sans mal à la fois les foudres des post-soixante-huitards et des gaullistes, des matheux et des deleuziens. Mauvais procès,
comme le disent certains ? Distinction à opérer entre le Badiou savant et le Badiou public ? Ou bien défaut dans sa philosophie, au contraire, vice de forme dans le système, voire imposture, comme le disent d’autres ? Il est certainement difficile de se faire un avis quand on n’est pas spécialiste de la théorie des ensembles ou de la topologie algébrique sur lesquels reposent principalement le travail du philosophe. L’art offre cependant un point de vue original sur la question.
Comme tous les philosophes qui se respectent, Badiou tient que l’art est une dimension essentielle de la pensée (quoique, au fond, cette position même pourrait être débattue). Au point d’ailleurs d’être lui-même artiste à ses heures perdus (romancier, dramaturge, poète). Or tout lecteur de Badiou se sera rendu compte que l’homme, en matière d’art, est loin d’être aussi impressionnant qu’en matière de philosophie. Une gravure d’Hubert Robert pour illustrer Logiques des mondes, Berlioz cité en exemple de grand musicien, Malraux ou Valéry bizarrement mis sur le même plan que Guyotat, Mallarmé vénéré, à l’ancienne, comme une sorte d’oracle… On est en droit de se méfier de quelqu’un qui a intitulé ses premiers romans Almagestes et Portulans, ou qui tient la description pompeuse que Thomas Mann fait dans Mort à Venise de son héros, Aschenbach, « séparé de la terre ferme par une étendue d’eau, [qui] allait, vision sans attaches, les cheveux au vent, là-bas, dans la mer et le vent, dressé sur l’infini brumeux », pour « une intuition directe de l’Idée ».
La plupart diront que c’est prendre le grand philosophe par le petit bout de la lorgnette, qu’il s’agit d’un détail, ou encore que ces goûts démodés sont simplement ceux d’un homme âgé, élevé aux humanités et aux lettres classiques, qui n’engagent en rien le système dans sa grande logique, voire même que ce mauvais goût – comme c’est le cas du Bourgeois gentilhomme ou, à l’inverse, du Neveu de Rameau – est au contraire, le signe de sa plus grande véracité, de sa plus grande authenticité. Mais on peut aussi penser, comme d’ailleurs Badiou le fait lui-même, que le Vrai est un tout, et que ces incohérences esthétiques trahissent d’une certaine manière celles de la pensée.
Proust stigmatise les Guermantes dans la Recherche parce qu’ils sont trop attachés aux questions de goût, on le sait. Ceux-ci ne jugent pas de la qualité d’une œuvre d’art ou d’une philosophie sur le fond, mais en fonction de critères mondains qui leur sont étrangers. Aussi bien passent-ils à côté des grands hommes que les Verdurin reconnaissent, eux, en dépit de leur vulgarité foncière. Mais tout est réversible chez Proust, on le sait aussi, et, in fine, le narrateur donne raison aux Guermantes en dénigrant à son tour les artistes qui avaient leur rond de serviette chez les Verdurin. De fait, le narrateur réalise au terme du Temps retrouvé qu’il leur manquait quelque chose pour être authentiquement grands, qui est sa découverte propre, et le trésor des Guermantes, à savoir : le Temps. Et pour cause. Qu’est-ce que c’est que le goût ? Le goût est ce par quoi un corps et un langage s’inscrivent dans le temps. Le goût est un rapport à ce qui passe, qui périt, qui est mort. Aussi bien, ce qui se révèle à travers les goûts de Badiou, c’est une forme de dérèglement dans le rapport au temps, non sans qu’on puisse d’ailleurs s’en étonner, dans la mesure où son système tout entier entretient un rapport étrange avec le temps. « Nous pouvons vivre en Immortels », répète ainsi souvent le philosophe, considérant à la fois que l’Histoire n’existe pas, ou que « la mort n’est qu’une conséquence logique » et, ce qui est égal, bien que cela sonne comme l’inverse, « qu’il n’y a que des événements ».
La philosophie d’Alain Badiou est fondée sur un geste volontariste d’annulation du temps qui procède de l’identification de l’ontologie aux mathématiques. Mais ce qu’on voit dans les goûts de Badiou, c’est que loin que ce geste produise l’éternité escomptée, il produit un effet d’étirement du temps, de survivance de l’ancien dans le nouveau, de coprésence du vivant et du mort qui caractérise le néoclassicisme – que Badiou considère de fait comme la forme culminante des arts (« En politique, la résurrection met au jour les invariants égalitaires de toute séquence, les invariants communistes. En art elle autorise les formes éclatantes et créatrices du néo-classicisme : imitation des Anciens dans la tragédie française, romanité de David en peinture, retour à Gluck de Berlioz… »). Autrement dit, il produit la version ridicule de l’éternité, qu’on appelle le kitsch, et qui est bien aussi pour cette raison la forme imposée aux régimes révolutionnaires. Ainsi, tout se passe comme si la cause du trouble que produit la philosophie de Badiou résidait dans ce fait que sa forclusion du temps y faisait retour de manière spectrale, à la manière des survivances warburgiennes.
Le grand absent des deux tomes de l’Etre et l’événement est à cet égard Alan Turing, seul parmi les logiciens à s’être intéressé à la question du temps des mathématiques, du temps de la décidabilité, du temps de la vérité, – et pour cause, il entendait construire des machines à calculer qui ne pouvaient fonctionner sans mémoire, dans un temps infini. Jean-Yves Girard diagnostique une maladie de la gödelite chez les héritiers du logicien autrichien. Badiou l’aura peut-être attrapée. Mais l’autre grand absent de cette œuvre est évidemment Hegel, bien qu’il soit abondamment cité, qui aura certainement eu l’intention de faire la même chose que Turing un siècle avant lui, faute d’en avoir les moyens. Précisément, dans L’Etre et l’événement, Alain Badiou fonde son axiomatique (gödelienne) sur le paradoxe de Russell. Le paradoxe de Russell déduit du fait qu’il est impossible de penser un ensemble de tous les ensembles qui ne s’appartiennent pas à eux-mêmes qu’il ne saurait y avoir d’ensemble de tous les ensembles. Mais un ensemble de tous les ensembles qui ne s’appartiennent pas eux-mêmes existe pourtant bel et bien. Nous en faisons tous les jours l’expérience. C’est justement le temps, dont la définition est d’être ce qu’il n’est pas et de n’être pas ce qu’il est. Tous les ensembles sont dans le temps, le temps réunit tous les ensembles, même ceux qui ne s’appartiennent pas à eux-mêmes, fût-ce effectivement, ou pour cette raison, sur le mode paradoxal d’un ensemble qui ne s’appartient lui-même pas à lui-même. Autrement dit, il y a bien un mystère ou un « scandale » de l’Etre, pour parler comme Paul, que Badiou affectionne, qui se déduit directement de l’axiomatique, et qui en est même comme le produit : l’ensemble de tous les ensembles, y compris ceux qui ne s’appartiennent pas à eux-mêmes, est, alors même qu’il ne devrait pas être. La contradiction est. Ou encore l’Un est, fût-ce sous la forme du non-être. Or donner de l’être à la contradiction a été le geste inaugural du hégélianisme. Avant Hegel, et jusqu’à Kant, dont L’Essai sur les grandeurs négatives marque néanmoins une étape importante, la contradiction n’était que néant, non-être. Mais que la contradiction soit, que la contradiction ait néanmoins un être, et que cet être soit précisément le temps, c’est la découverte propre de Hegel, qui le rapproche d’ailleurs tant de Proust.
Hegel, est-ce un hasard, était, lui, un extraordinaire esthète. Infiniment supérieur à Kant, qui n’aimait que des croûtes. L’art comme critère de la vérité ? Il serait intéressant de relire l’histoire de la philosophie récente à cette aune. Au fond, n’est-il pas vrai que même Deleuze déçoit sur ce plan, avec son Bacon, son Beckett, son Proust, et même ses deux volumes sur le cinéma (où il n’est presque pas question d’art vidéo ou de télévision) qui restent attachés à des figures qui paraissent plus anciennes que son univers philosophique ?… Même chez Lyotard, qui aura été le seul de sa génération à tenter une véritable approche de l’art contemporain, avec les Immatériaux, le doute plane où se mélangent Adami, Arakawa et Buren. Reste, aujourd’hui, Rancière et Latour. Et sans doute encore des questions à poser.
articles liés
Paris noir
par Salomé Schlappi
Du blanc sur la carte
par Guillaume Gesvret
« Toucher l’insensé »
par Juliette Belleret

